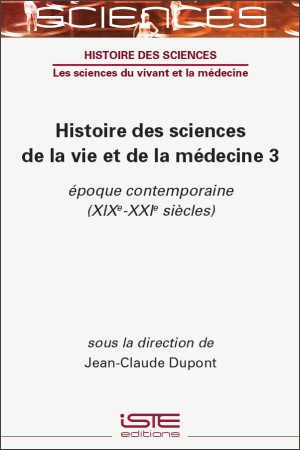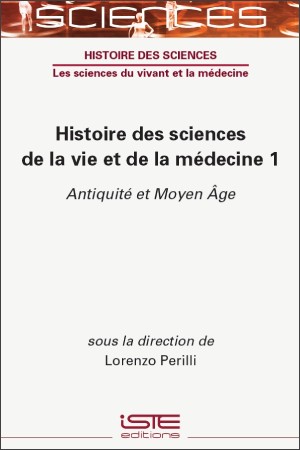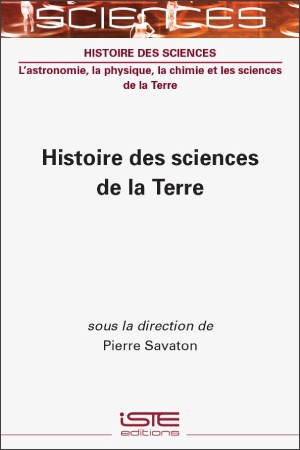– Paperback:
Delivery time: approximately two weeks
Deliveries only within metropolitan France, Belgium, Switzerland and Luxembourg
Printed in color
An ebook version is provided free with every hardcopy ordered through our website
It will be sent after the order is completed
Offer not applicable to bookshops
– Ebook:
Prices reserved for private individuals
Licenses for institutions: contact us
Our ebooks are in PDF format (readable on any device)
Faire l’histoire récente des sciences de la vie est une entreprise passionnante, mais exigeante. Certaines disciplines émergent tandis que d’autres disparaissent ; surtout, elles s’entrelacent désormais et se chevauchent, déplaçant sans cesse leurs frontières. Pourtant, en dépit de la complexité réelle qui en résulte, certains concepts transversaux fondamentaux continuent de structurer la recherche, conférant à la biologie une cohérence et une identité d’ensemble.
Histoire des sciences de la vie et de la médecine 3 fait le choix d’une histoire conceptuelle, visant à rendre compte de la constitution contemporaine du domaine des sciences de la vie. Sont ainsi abordées quelques-unes des notions les plus représentatives sur les plans historique et épistémologique, c’est-à-dire celles qui ont particulièrement structuré le champ du vivant depuis les XIXe et XXe siècles. Dix concepts biologiques clés font l’objet d’une analyse : l’origine de la vie, l’évolution, l’écosystème, la cellule, le métabolisme, le gène, le développement, l’immunité, le cerveau et la pathologie.
(FR) 1. Les théories sur les origines de la vie aux XIXe et XXe siècles
2. La réception de la théorie de l’évolution
3. Histoire de la notion d’écosystème
4. Les cellules, unités morphologiques et physiologiques de l’organisme
5. Le concept de métabolisme : des commencements à la maturité
6. Histoire du concept de gène
7. Microcosme, type, individuation : comprendre le développement animal
8. Une histoire conceptuelle de l’immunologie
9. Cerveaux humains : représentations, explorations, stimulations
10. Médecine moderne et sciences : une histoire de ruptures
Jean-Claude Dupont
Jean-Claude Dupont est professeur émérite d’histoire et de philosophie des sciences à l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens), il est spécialiste de l’histoire des sciences du vivant et de la médecine.
Chapitre 1
Les théories sur les origines de la vie aux XIXe et XXe siècles (pages : 9-26)
Ce chapitre analyse les conceptions sur les origines de la vie depuis celles des premiers évolutionnistes du XIXe siècle, dont notamment Jean-Baptiste Lamarck (1749-1829) et Charles Darwin (1809-1882), jusqu’aux approches expérimentales en conditions prébiotiques et aux développements de l’astrobiologie au XXe siècle.
Chapitre 2
La réception de la théorie de l’évolution (pages : 27-43)
La réception de la théorie de l’évolution a impliqué un dépassement du fixisme, puis du transformisme néo-lamarckien. La théorie darwinienne fut reçue, mais transformée au XXe siècle, dans le néo-darwinisme. Cette réception dépendit des apports et insuffisances du darwinisme. Au-delà du caractère incomplet du pouvoir explicatif du gradualisme et de la sélection naturelle, les découvertes du XXe siècle ont amélioré cette théorie et proposé de nouveaux modèles évolutifs.
Chapitre 3
Histoire de la notion d’écosystème (pages : 45-68)
Ce chapitre retrace l'histoire de la notion d'écosystème, paradigme central de la science écologique, depuis son émergence dans les années 30 jusqu'à son institutionnalisation dans les années 1950 et 1960. Ce concept aux facettes scientifiques extrêmement diversifiées a très régulièrement suscité des controverses épistémologiques entre approches holistes et méthodologies réductionnistes, entre grands principes cybernétiques ou thermodynamiques et règles d'application concrètes. Il ne cesse encore d'interroger la place des perturbations humaines, tout à la fois révélatrices des lois écologiques et cas limites des dynamiques écosystémiques.
Chapitre 4
Les cellules, unités morphologiques et physiologiques de l’organisme (pages : 69-94)
Ce chapitre relate comment la notion de cellule s’est formée et transformée de façon à représenter les unités conjointement morphologiques et physiologiques constitutives des divers organismes. De multiples dispositifs élémentaires intégrés au sein du protoplasme forment une individualité complexe apte à se reproduire : depuis sa genèse au sein de la physiologie allemande, la cytologie a tendu à modéliser les processus caractéristiques de cette organisation.
Chapitre 5
Le concept de métabolisme : des commencements à la maturité (pages : 95-128)
Ce chapitre décrit comment le concept de métabolisme s’est progressivement affiné de l’époque de Lavoisier à celle de Claude Bernard, puis sous l’effet d’une science nouvelle, la biochimie, jusqu’aux années 1960 et l’aube de la biologie moléculaire. Le fil conducteur suivi est celui du métabolisme énergétique, historiquement le premier construit et emblématique de l’histoire de la biochimie.
Chapitre 6
Histoire du concept de gène (pages : 129-155)
Ce chapitre examine quelques jalons de l’histoire du concept de gène, depuis sa « préhistoire » dans l’Antiquité, jusqu’à l’ère dite « post-génomique » à l’époque contemporaine. Ces jalons permettent de comprendre comment, par l’agrégat de différents courants scientifiques, théoriques et idéologiques, le concept de gène s’est imposé comme un des concepts centraux de la biologie.
Chapitre 7
Microcosme, type, individuation : comprendre le développement animal (pages : 157-188)
Ce chapitre retrace les étapes fondatrices de la théorisation du développement animal dès la naissance de la biologie, vers 1800, jusqu’aux avancements contemporains de la biologie développementale, en passant par la création de l’embryologie comparée et de sa différenciation en une science expérimentale. Le développement y apparaît progressivement comme un cycle d’individuation, dont le plan repose sur un patrimoine génomique conservé dans de larges portions de la phylogenèse.
Chapitre 8
Une histoire conceptuelle de l’immunologie (pages : 189-208)
L’immunologie s’est développée dans le contexte des maladies infectieuses, avec l’hôte paradigmatique (le “soi”) comme centre conceptuel de la discipline. Cependant, un second thème, d’ordre “écologique” et resté largement en sommeil jusqu’à la fin du XXe siècle, a réorienté l’immunologie. Celle-ci est passée d’une approche dichotomique “soi/non-soi” à une perspective axée sur les relations complexes entre l’organisme et son environnement. Ce texte présente l’évolution historique du développement théorique de l’immunologie en soulignant ces orientations concurrentes.
Chapitre 9
Cerveaux humains : représentations, explorations, stimulations (pages : 209-226)
Ce chapitre retrace une histoire du cerveau humain. De ses premières représentations aux motifs et procédés d'explorations puis de stimulations, il s'agit d'analyser pourquoi, en quoi et comment l'organe cérébral forme un véritable objet de recherche. Le fil conducteur est celui des représentations plurielles associées à cet organe, motivant divers moyens d'agir sur ce dernier.
Chapitre 10
Médecine moderne et sciences : une histoire de ruptures (pages : 227-250)
Ce chapitre évalue la thèse selon laquelle les progrès de la médecine moderne reposeraient principalement sur l’apport des sciences de la vie. Il retrace le récit positiviste du progrès médical avant d’évoquer les critiques dont celui-ci a fait l’objet au cours des années 1970. Il est soutenu que ces deux récits se sont moins opposés qu’interfécondés pour dessiner les contours de la rationalité médicale moderne.