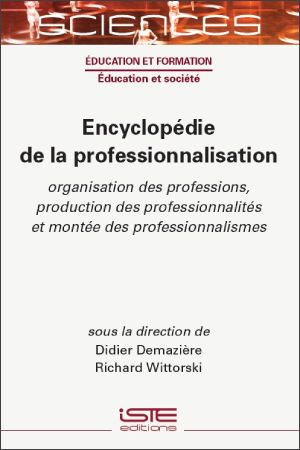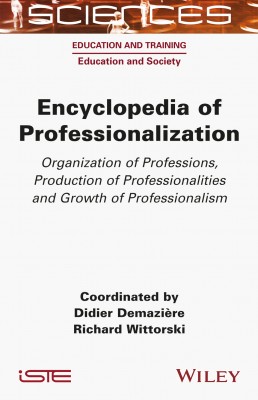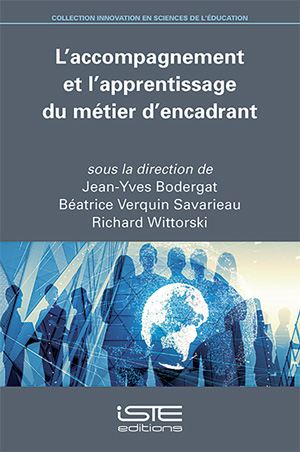– Papier (Collections classiques, Encyclopédie SCIENCES) :
Livraison offerte pour toute commande directe effectuée sur le site istegroup.com
Délai de livraison : environ deux semaines
Envois uniquement vers : France métropolitaine, Belgique, Suisse et Luxembourg
Impression en couleur
Un ebook de l’ouvrage (à l’exception des titres de l’Encyclopédie SCIENCES) est offert pour tout achat
de sa version papier sur notre site, il vous sera envoyé après la finalisation de votre commande
Offre non applicable aux librairies
– Ebook (Collections classiques, Encyclopédie SCIENCES, Abrégés) :
Prix réservé aux particuliers
Pour les institutions : nous contacter
Nos ebooks sont au format PDF (compatible sur tout support)
La professionnalisation est devenue une évidence dans le monde du travail et de l’éducation. Elle constitue une réalité incontournable pour une grande variété de professions, d’organisations publiques et privées, ainsi que pour les filières de formation et de perfectionnement. Cependant, il s’agit d’une notion polysémique, aux significations parfois contradictoires. Elle représente tout autant un impératif managérial imposé par les hiérarchies dans les organisations productives qu’un idéal de service ou de qualité du travail, défini et défendu par les professionnels.
Encyclopédie de la professionnalisation explore et explicite les débats suscités par la professionnalisation, à partir de traditions de recherche ancrées dans des disciplines plurielles, d’enquêtes empiriques rigoureuses et de conceptualisations renouvelées.
Trois grandes acceptions de la professionnalisation sont dégagées et examinées : la structuration de métiers en quête de reconnaissance et d’autonomie ; la montée de professionnalismes porteurs de nouvelles exigences au travail ; et la production de professionnalités renouvelées, à travers des dispositifs de formation comme au coeur des situations de travail.
Partie 1. La « professionnalisation, fabrication des professions »
Partie 2. La « professionnalisation, montée des professionnalismes »
Partie 3. La « professionnalisation, construction des professionnalités »
Didier Demazière
Didier Demazière est directeur de recherche au CNRS, au Centre de sociologie des organisations (Sciences Po). Sociologue du travail, ses recherches portent sur les marchés du travail, les systèmes de rémunération, les carrières professionnelles, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.
Richard Wittorski
Richard Wittorski est professeur et directeur du Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et formation à l’Université de Rouen. Ses travaux portent sur les relations entre travail et formation, ainsi que sur la professionnalisation dans des métiers et des secteurs d’activité variés.
Chapitre 1
Professionnalisation, prudence et vulnérabilités (pages : 9-39)
Les mêmes activités sont protégées, dans de nombreux pays, de la concurrence sur les marchés et des interférences de non-professionnels avec le travail. Or aucune théorie n’avait expliqué cette régularité de façon satisfaisante. Le concept philosophique de prudence permet d’élucider cette énigme (les fragilités de la prudence expliquent les protections), selon un paradigme qui éclaire aussi les difficultés contemporaines des activités prudentielles.
Chapitre 2
Professionnalisations : le mystère des frontières (pages : 41-74)
Dans le domaine de la sociologie des professions la professionnalisation désigne l’émergence et l’institutionnalisation de groupes professionnels ou de professions. On argumente ici que ces groupes sont des professionnalisations, entendues comme un processus fluide et permanent de division du travail, de déplacements de frontières temporaires et de flux d’événements pour partie contrôlés et pour partie imprévisibles.
Chapitre 3
Recompositions professionnelles face aux nouvelles exigences et normes au travail (pages : 77-113)
L’évolution des normes et exigences au travail, entre professionnalisation et intensification, doit être interprétée comme une mise en tensions de différentes façons de concevoir l’activité professionnelle, ses normes et ses valeurs. Ces changements, rarement univoques, redéfinissent les responsabilités, la régulation et la qualité du travail, tout en posant des défis à l'autonomie professionnelle. Quatre vecteurs de transformations normatives sont particulièrement étudiés.
Chapitre 4
Les luttes pour la définition du « travail bien fait » (pages : 115-149)
Ce chapitre analyse les tensions et luttes autour de la définition du "travail bien fait". Il analyse comment cette notion structure les groupes professionnels, établit des normes et hiérarchies internes et externes. Il souligne son évolution sous l'influence d’acteurs externes aux groupes professionnels que sont l'État, le management et les usagers. Il explore la remise en cause de l'autonomie professionnelle et la redéfinition du professionnalisme qui en découle, en fonction de la reconnaissance du rôle dans la société que les groupes professionnels ont pu obtenir.
Chapitre 5
La professionnalisation comme objet de tensions entre logiques institutionnelles, collectives et individuelles (pages : 151-171)
Le texte explore les tensions de logiques institutionnelles, collectives et individuelles qui sous-tendent les dispositifs de professionnalisation, considérés comme expression du projet identitaire des responsables institutionnels sur les groupes ou les individus à professionnaliser, et l'engagement de ces derniers dans ces dispositifs comme un indicateur de leurs propres projets d’identité. Le tout est illustré par l’une de nos recherches dans le secteur agro-alimentaire.
Chapitre 6
L’alternance en formation : analyseur de la professionnalisation des parcours de formation (pages : 175-201)
Ce chapitre propose une réflexion sur l’émergence du concept d’alternance dans le double champ : éducation scolaire et formation des adultes. Ce terme est mis en dialogue avec les questions de temporalités et d’espaces. Le chapitre interroge l’usage et les plus-values de l’alternance à la lumière des évolutions stratégiques impactant les organisations de travail et les organismes de formation.
Chapitre 7
Professionnalisation, situation de travail et rapports sociaux (pages : 203-223)
Ce chapitre propose de mettre en regard les modèles de professionnalisation et les choix socio-politiques considérant que ce qui s’apprend relève à la fois d’une profession et de son inscription dans un ordre social. Nous passerons en revue trois visions : la situation de travail comme opportunité d’intégrer métier et ordre social ; le salarié-acteur et ses compétences ; l’activité et l’organisation du travail au cœur des modèles. La professionnalisation concerne autant la pédagogie qu’une vision de l’homme au travail dans un contexte socio-politique.
Chapitre 8
L’apprentissage sur le lieu de travail : conceptions et pratiques (pages : 225-244)
L’évolution des normes et exigences au travail, entre professionnalisation et intensification, doit être interprétée comme une mise en tensions de différentes façons de concevoir l’activité professionnelle, ses normes et ses valeurs. Ces changements, rarement univoques, redéfinissent les responsabilités, la régulation et la qualité du travail, tout en posant des défis à l'autonomie professionnelle. Quatre vecteurs de transformations normatives sont particulièrement étudiés.
Chapitre 9
L’analyse de l’activité en sciences de l’éducation et de la formation : enjeux, principes et perspectives (pages : 245-266)
En partant du constat que la compréhension des dynamiques qui participent à la professionnalisation du sujet par, dans ou à partir des situations de travail constitue un enjeu à la fois scientifique et praxéologique, ce chapitre traite des différentes approches par l’analyse de l’activité mobilisées dans le domaine des sciences de l’éducation et de la formation.
Chapitre 10
Professionnalisme et imagination auto/biographique (pages : 267-288)
L’imagination narrative auto/biographique donne la capacité d’être réflexif et de jouer avec le monde symbolique des autres et le nôtre. Des professionnels pratiquent cette imagination avec un esthétique satisfaisant et interdisciplinaire : pour eux, la vie professionnelle inclut les processus intersubjectifs, conscients et inconscients, cognitifs et émotionnels. Si le professionnalisme est compromis par l’intensification du travail et le culte de pratique factuelle, la création d’imagination auto/biographique devient plus vitale.